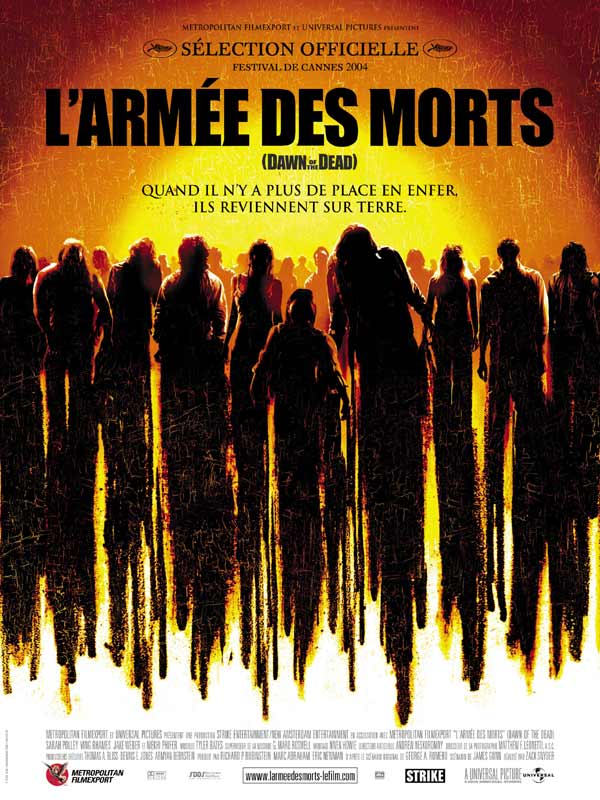Séance 02
Les villes modernes
Oral
Selon vous, qu'est-ce qui fait que l'isolement a augmenté entre 2010 et 2020 ?
Débat
Selon vous, les villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui aggravent-elles le sentiment de solitude ?
Vous répondrez en vous appuyant sur les oeuvres étudiées en cours et sur votre culture personnelle.
Notes
1. "Urbanifié" (néologisme) : habitué à la vie urbaine.
Document A

F. L. Wright, "Falling Waters", la maison sur la cascade, 1936.
Le bonheur du citoyen convenablement "urbanifié1" consiste à s'agglutiner aux autres dans le désordre, abusé qu'il est par la chaleur hypnotique et le contact contraignant de la foule. La violence et la rumeur mécanique de la grande ville agitent sa tête "urbanifiées" - comme le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres, les cris des animaux ou les voix de ceux qu'il aimait remplissaient autrefois son coeur. [...]
Une agitation perpétuelle l'excite, le dérobe à la méditation et à la réflexion plus profondes qui furent autrefois siennes lorsqu'il se vivait et se mouvait sous un ciel pur, dans la verdure dont il était, de naissance, le compagnon.
Il a échangé son commerce originel avec les rivières, les bois, les champs et les animaux, pour l'agitation permanente, la souillure de l'oxyde de carbone et un agrégat de cellules à louer posées sur la dureté d'un sol artificiel. "Paramounts", "Roxies", boîtes de nuit, bars, voilà pour lui l'image de la détente, les ressources de la ville. Il vit dans une cellule, parmi d'autres cellules, soumis à la domination d'un propriétaire qui habite généralement l'étage au-dessus. Propriétaire et locataire sont la vivante apothéose du loyer. Le loyer ! La ville n'est jamais qu'une forme ou une autre de loyer. S'ils ne sont pas encore de parfaits parasites, ses habitants vivent parasitairement.
Ainsi, le citoyen parfaitement "urbanifié", perpétuel esclave de l'instinct grégaire, est soumis à une puissance étrangère, exactement comme le travailleur médiéval était l'esclave d'un roi ou d'un État. Les enfants poussent, parqués par milliers dans des écoles construites et dirigées comme des usines : des écoles qui produisent des troupeaux d'adolescents, comme une machine produit des souliers.
F. L. Wright, The Living city, 1958 (cité dans F. Choay, L'Urbanisme, utopies et réalités, coll. Points, éd. du Seuil, 1965).
Document B
Les moralistes ont, depuis longtemps, observé que les citadins flânent dans les endroits les plus actifs, s'attardent dans les bars et les pâtisseries, boivent des sodas dans les cafétérias ; et cette constatation les afflige. Ils pensent que si les mêmes citadins avaient des logements convenables et disposaient d'espaces verts plus abondants, on ne les trouverait pas dans la rue.
Ce jugement exprime un contresens radical sur la nature des villes. Personne ne peut tenir une maison ouverte dans une grande ville, et personne ne le désire. Mais, que les contacts intéressants, utiles et significatifs entre citadins se réduisent aux relations privées, et la cité se sclérosera. Les villes sont pleines de gens avec lesquels, de votre point de vue ou du mien, un certain type de contact est utile ou agréable ; vous ne voulez pas, pour autant, qu'ils vous encombrent. Eux non plus, d'ailleurs. J'ai indiqué plus haut que le bon fonctionnement de la rue était lié à l'existence, chez les passants, d'un sentiment inconscient de solidarité.
Un mot désigne ce sentiment : la confiance. Dans une rue, la confiance s'établit à travers une série de très nombreux et très petits contacts dont le trottoir est le théâtre. Elle naît du fait que les uns et les autres s'arrêtent pour prendre une bière au bar, demandent son avis à l'épicier, au vendeur de journaux, échangent leur opinion avec d'autres clients chez le boulanger, saluent deux garçons en train de boire leur coca-cola, réprimandent des enfants, empruntent un dollar au droguiste, admirent les nouveaux bébés. Les habitudes varient : dans certains quartiers les gens s'entretiennent de leur chien, ailleurs de leur propriétaire.
La plupart de ces actes et de ces propos sont manifestement triviaux ; mais leur somme, elle, ne l'est pas. Au niveau du quartier, c'est la somme des contacts fortuits et publics, généralement spontanés qui crée chez les habitants le sentiment de la personnalité collective et finit par instaurer ce climat de respect et de confiance dont l'absence est catastrophique pour une rue, mais dont la recherche ne saurait être institutionnalisée.
J. Jacobs, The Death and life of Great American Cities, 1961 (cité dans F. Choay, L'Urbanisme, utopies et réalités, une anthologie, coll. Points, éd. du Seuil, 1965).