Étude de document n°1
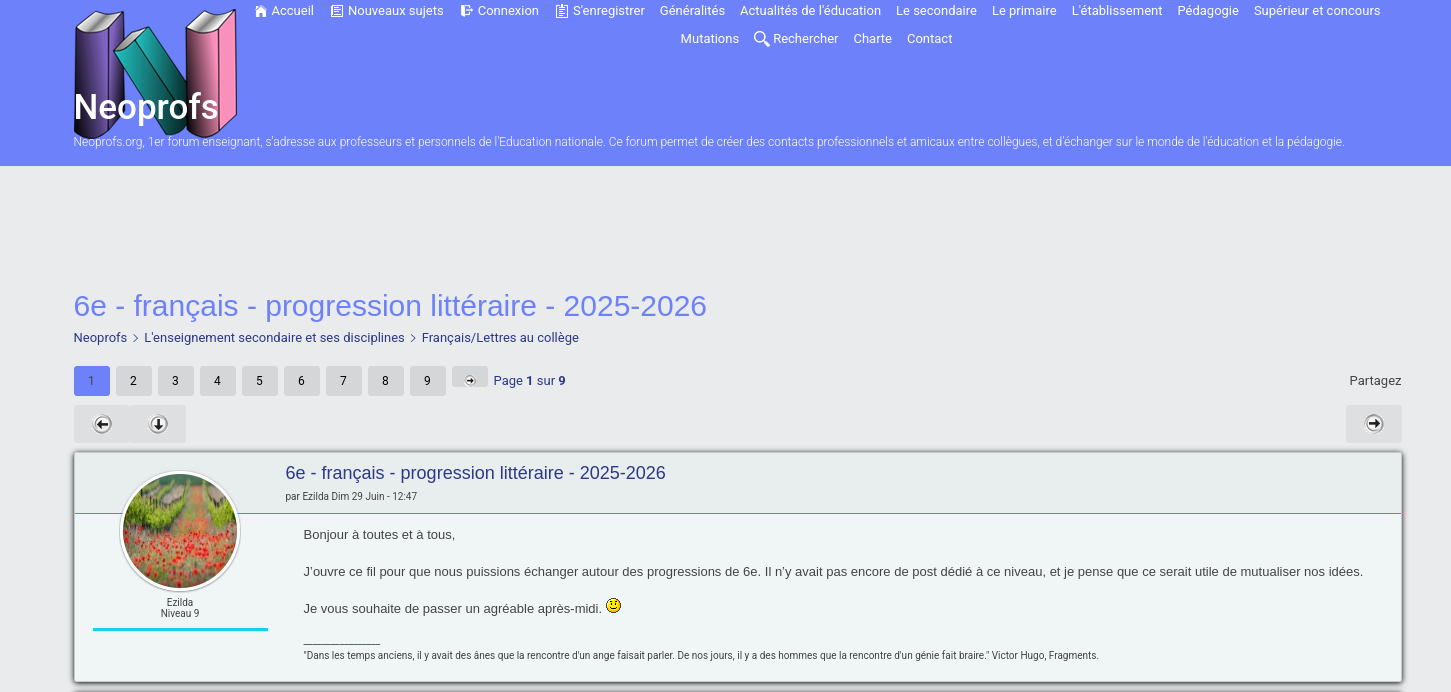
L'ergonomie et la psychologie du travail ont insisté sur la distinction entre tâche prescrite et activité réelle. La tâche est ce qui est à faire, l'activité ce qui se fait (Leplat & Hoc, 1983). [...] Mais, en fait, il faut peut-être franchir un pas supplémentaire : activité réalisée et activité réelle ne se recoupent pas non plus. C'est vrai en général, et Vygotski le disait à sa manière pour la psychologie dans son ensemble : "L'homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées." [...] Là encore, le réel de l'activité c'est aussi ce qui ne se fait pas, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on cherche à faire sans y parvenir – les échecs –, ce qu'on aurait voulu ou pu faire, ce qu'on pense ou qu'on rêve pouvoir faire ailleurs. Il faut y ajouter – paradoxe fréquent – ce qu'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire ou encore ce qu'on fait sans vouloir le faire. Sans compter ce qui est à refaire.
Clot, Y. (2006). La fonction psychologique du travail (pp. 91-129). Presses Universitaires de France.
Àtant son père aperceut, que vrayment il estudioyt tresbien et y mettoit tout son temps, toutesfoys qu’en rien ne prouffitoyt. Et que pys est, qu’il en devenoyt fou niays tout resveux et rassoté.
Rabelais, F. (1535). Gargantua. Comment Gargantua fut mys soubz aultres pedaguoges. Chapi. xv.
Une définition institutionnelle des termes, stabilisée en 1996 dans les documents d'accompagnement, distinguait deux niveaux de cette activité : concevoir une progression (déterminer un ordre des notions et séquences successives pour établir un itinéraire dans les apprentissages) et fixer une programmation (distribuer chronologiquement séquences et séances dans le calendrier scolaire en tenant compte de ses contraintes). À ce niveau, progression et programmation relèvent de cette activité centrale de l'enseignant qu'est la planification, définie par Tochon comme l'"organisation cognitive relative à l'activité de préparation des leçons" selon différentes échelles de temps (annuelle, mensuelle, hebdomadaire, journalière).
Nonnon, É. (2010). La notion de progression au cœur des tensions de l'activité d'enseignement. Repères, 41, 5‑34.
Plusieurs types de progressions existent dans le domaine de l'éducation : la progression linéaire, qui présente les objets à enseigner du plus simple au plus complexe, la progression par accumulation, qui découpe en parties les objets à enseigner pour en comprendre l'ensemble, et la progression spiralaire, qui permet l'étude du phénomène par approfondissements successifs. Pour l'enseignement du français, la progression spiralaire fait consensus chez les didacticiens, puisqu'elle permet non seulement d'intégrer les deux autres types de progression, mais également de tenir compte de la complexité des phénomènes de langue à l'étude.
Boublil-Ekimova, H., & Stan, C. A. (2018). Macroplanification en enseignement : Principes, concepts et critères. Presses de l’Université Laval.
On peut envisager une programmation organisée autour des savoirs ou autour des compétences ; le Québec organise depuis longtemps la programmation autour de compétences et si la France a longtemps privilégié les savoirs comme organisateurs des programmes, la tendance est clairement à un infléchissement vers les compétences (cf. le "socle commun de connaissances et de compétences" en parallèle des programmes). Cet infléchissement est le fruit d'un long processus, qui a conduit, dans la plupart des pays occidentaux, à ce "nouveau pilotage des enseignements scolaires" (Lebeaume, 2011, p. 7), qui a pour effet, en vertu d'une certaine transversalité des compétences affichées, "un ébranlement voire une déconstruction des disciplines scolaires" dans la scolarité obligatoire (ibid.).
Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I. & Lahanier-Reuter, D. (2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
Observez les documents élaborés au sein de l'Académie de Nantes, en particulier le document Construire une argumentation. Quelles remarques vous inspire-t-il ?
Les prérequis sont des objectifs considérés comme devant être maîtrisés au départ de l’apprentissage, sous peine d’insuccès. Ils ne doivent pas être confondus avec les préacquis qui sont les objectifs réellement maîtrisés au départ de l’apprentissage, qu’ils soient prérequis ou non pour cet apprentissage. Idéalement, tous les prérequis devraient être préacquis. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas, et cela justifie l’importance du rappel actif des prérequis permettant à l’élève de remédier à d’éventuelles lacunes.
Gérard, F. & Roegiers, X. (2009). Des manuels scolaires pour apprendre : Concevoir, évaluer, utiliser (pp. 67-81). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
Le travail de définition des paliers d'une compétence consiste à déterminer des niveaux de difficulté et/ou de complexité progressifs, chaque palier représentant un énoncé de niveau supérieur par rapport au précédent. Pour déterminer ces paliers, on peut agir sur différentes variables. [...] Supposons par exemple qu'en français, on travaille sur une compétence d'argumentation d'une position sur un thème donné, comme l'utilisation des téléphones portables en classe, ou le tabagisme ; on peut avoir une progression "matière", sous la forme d'apprentissages des ressources langagières, qui se combine avec un aspect "démarches", visant un niveau croissant d'autonomie de l'élève dans le développement de la compétence : par exemple, l'élève commence par reconnaître les arguments pertinents suite à la lecture réfléchie d'un document (palier 1), ensuite il complète une liste d'arguments par d'autres (palier 2), enfin, il produit lui-même un point de vue personnel argumenté (palier 3)…
Roegiers, X. (2011). Curricula et apprentissages au primaire et au secondaire : La Pédagogie de l'Intégration comme cadre de réflexion et d'action (pp. 203-222). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
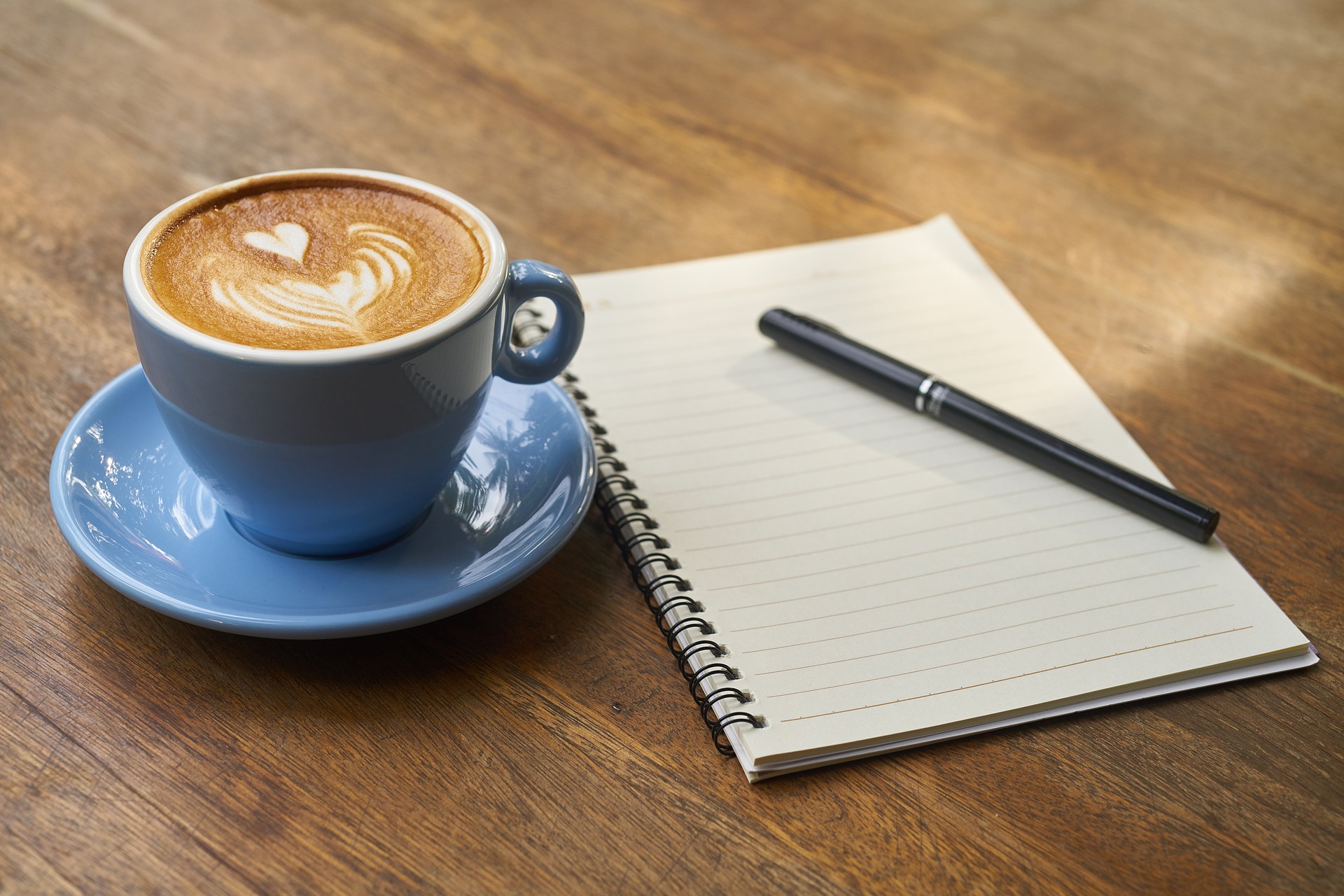
Que retenez-vous de cet apport sur la programmation ? Quelles questions (sur ce sujet, ou sur un autre) ?